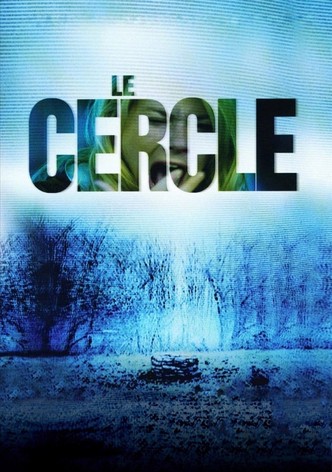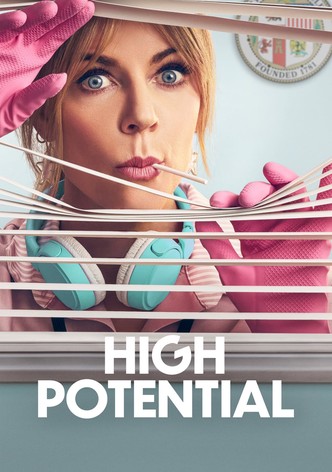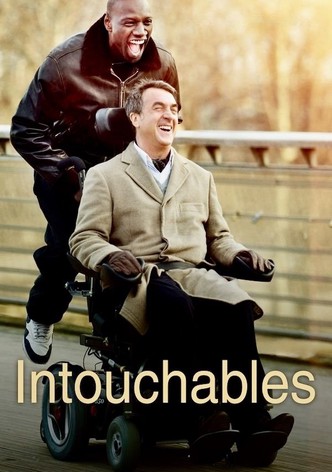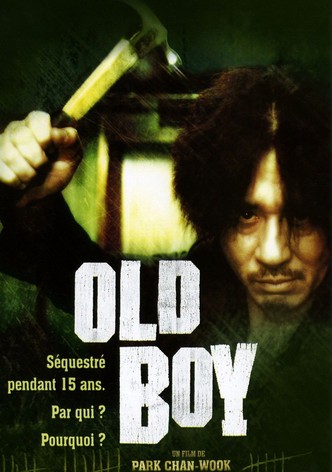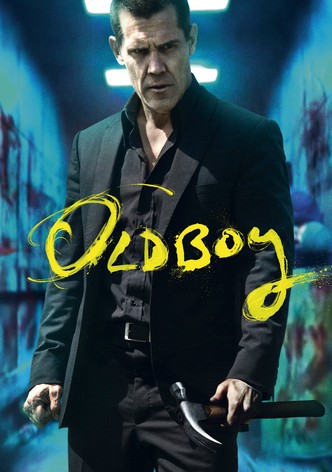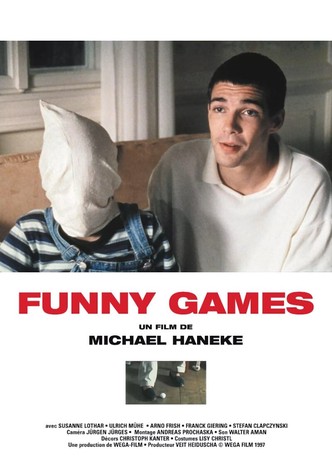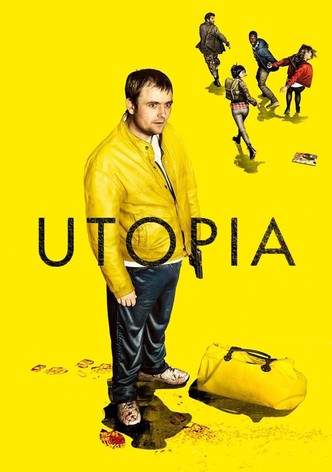Hollywood adore recycler ses succès. On prend une œuvre culte, on change le casting, on polit un peu les bords, on met plus de budget… et on espère recréer la magie. Mais très souvent, ce qui faisait le charme de l’original se perd. Ce texte ne veut pas enterrer tous les remakes – certains sont brillants – mais plutôt rappeler que, bien souvent, la première version reste la plus audacieuse, la plus risquée, la plus vivante.
Voici donc une sélection JustWatch très personnelle de films et de séries que je trouve au dessus de leur remake, reboot ou adaptation. J’essaie de rester objectif, mais ne m’en voulez pas si je verse dans la subjectivité sur certains titres. Des polars britanniques aux comédies françaises, du J-horror aux thrillers hongkongais, ces œuvres ont quelque chose en commun : elles n’avaient pas besoin d’être « améliorées ». Si vous ne connaissez que la copie, il est temps de remonter à la source.
Ring (1998)
Avec Ring (1h31), Hideo Nakata redéfinit le film d’horreur en choisissant la suggestion plutôt que le choc. Une cassette vidéo maudite, un coup de téléphone, sept jours à vivre : la prémisse est simple, presque banale, mais la mise en scène installe une angoisse qui progresse à pas lents, sans jamais éclater en grands effets.
Le Cercle - The Ring (2002), son remake américain, est efficace, et même très réussi, mais il a tendance à montrer là où Ring préfère laisser l’imagination travailler. Le film japonais joue sur le hors-champ, sur les silences. C’est l’un des premiers films d’horreur que j’ai regardés, et l’un des derniers. J’en ai encore des frissons en écrivant ces lignes.
Le Dîner de cons (1998)
Le Dîner de cons (1h20) est sans doute l’une des comédies françaises les plus citées, les plus rejouées, les plus rabâchées – et pourtant, elle fonctionne toujours. Francis Veber enferme ses personnages dans un appartement, tend un fil, et laisse la catastrophe se dérouler avec une précision d’horloger. Jacques Villeret est bouleversant de naïveté lunaire, Thierry Lhermitte d’une cruauté drôle mais troublante ; chaque réplique est une petite bombe, chaque silence un malaise délicieux. Le spectateur fait entièrement partie du film et agit presque comme un nouveau personnage, car nous sommes amenés à participer aux fous rires et à la gêne.
Porté par Steve Carell et Paul Rudd, le remake américain, Dinner for Schmucks (2010), traduit tout… sauf l’essentiel. C’est plus bruyant, plus gras, comme si l’on avait peur de laisser un moment de flottement. On perd l’ambiguïté, cette étrange alchimie où la gêne se mêle à une vraie tendresse pour ce « con » qu’on finit par trouver beaucoup plus humain que ceux qui se moquent de lui.
Broadchurch (2013–2017)
Avec Broadchurch (3 saisons), on touche à ce que le polar télévisuel a fait de plus puissant ces dix dernières années. Dans ce village côtier du sud-ouest de l’Angleterre, la mort d’un jeune garçon brise toute la communauté locale. Olivia Colman et David Tennant forment un duo bouleversant d’humanité : elle, tout en douceur ; lui, épuisé, nerveux, rongé par ses propres démons. La mise en scène laisse respirer les silences, les regards, les paysages battus par le vent, avec une bande sonore toute aussi belle que les paysages.
Face à cela, Gracepoint (2014) ressemble à une photocopie trop nette : même intrigue, même David Tennant, mais sans cette mélancolie très britannique qui imprègne chaque épisode. On se demande encore aujourd’hui pourquoi ce remake américain a été fait…
Le Bureau des Légendes (2015–2020)
Avant The Agency (2024), il y avait Le Bureau des Légendes (5 saisons), et c’est peu dire que la marche était haute. Éric Rochant y invente une série d’espionnage à la française, très loin des gadgets et des poursuites : ici, tout se joue dans les cafés, la lenteur, les discussions, les manipulations. Mathieu Kassovitz campe un agent aussi brillant que paumé, coincé entre ses identités de couverture et la personne qu’il est encore vaguement chez lui. La mise en scène, d’une sobriété quasi documentaire, donne l’impression de regarder un vrai service de renseignement au travail.
Le remake américain tire vers le suspense spectaculaire, les visages connus (Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Richard Gere…), un rythme plus marqué, une tension plus grande – tout ce que la série originale avait soigneusement évité pour rester crédible. Si vous aimez Homeland (2011-2020) mais que vous rêvez d’une version plus réaliste, plus nuancée, plus sèche, vous savez où aller.
HPI (2021–2025)
Dans HPI (4 saisons), Audrey Fleurot fait exploser l’écran en Morgane Alvaro, mère solo surdouée qui résout des enquêtes entre deux galères de vie. La série aurait pu n’être qu’une énième série procédurale avec un personnage excentrique mais intelligent, mais elle trouve un ton à part : couleurs pop, humour assumé, énergie brute et vraie tendresse pour son héroïne. Morgane n’est pas une caricature de cerveau brillant ; elle est bordélique, émotive, parfois à côté de la plaque, souvent épuisée – et c’est précisément ce qui la rend si attachante.
Le remake américain, High Potential (2024-), coche les mêmes cases en surface, mais peine à retrouver ce mélange très particulier de fantaisie et de sincérité. Fleurot porte HPI par son charisme, ses ruptures de ton et cette manière de dynamiter chaque scène sans jamais saboter l’émotion. Je comprends cependant que l’idée de base a un fort potentiel, et que la série originale soit difficilement transportable tant elle est « franchouillarde » Nous c’est ce qu’on aime, mais outre-Atlantique, peut-être pas !
Intouchables (2011)
Avec Intouchables (1h52), Olivier Nakache et Éric Toledano signent un film populaire au meilleur sens du terme : accessible, drôle, émouvant, piquant, mais jamais niais. Omar Sy et François Cluzet ont une alchimie qui perce l’écran. Le film ose le mauvais goût, les vannes borderline, la légèreté au milieu de la douleur, sans jamais perdre le respect des personnages.
The Upside (2019), son remake américain, reste un feel-good movie divertissant, mais beaucoup plus lisse. Les situations qui, dans l’original, frôlaient l’irrécupérable sont arrondies, les aspérités gommées, le ton moins irrévérencieux. Intouchables évoquait le thème du handicap avec beaucoup de sincérité. Cette sincérité se perd dans un film trop plat, qui fait trop attention à ne jamais frôler la moindre limite. L’histoire d’amitié fonctionne encore grâce à Kevin Hart et Bryan Cranston, mais l’électricité entre les deux personnages n’a plus cette intensité qu’on aime tant.
Old Boy (2003)
Avec Old Boy (2h00), Park Chan-wook signe un film qui s’imprime dans le système nerveux, et pour longtemps. On y suit un homme séquestré pendant quinze ans sans explication, qui est libéré du jour au lendemain et se lance dans une quête qui tourne à la descente aux enfers. Violence, couleurs saturées, mise en scène millimétrée : tout concourt à une expérience à la fois repoussante et hypnotique. Old Boy prend parti à chaque seconde. Le film n’essaie pas de plaire, d’être lisse, d’être beau, et ce côté brut lui donne un caractère dingue.
Confié à Spike Lee et emmené par Josh Brolin, le remake américain, sorti en 2013, reprend l’ossature de l’intrigue mais en perd la fièvre. L’original s’enfonce dans un cauchemar, alors que la copie ressemble davantage à un thriller appliqué, certes professionnel, mais beaucoup moins hanté. On se souvient de la version coréenne comme d’un choc moral et esthétique. La version US, elle, s’oublie vite.
Funny Games (1997)
Dans Funny Games (1h49), Michael Haneke démonte méthodiquement le plaisir du spectateur devant la violence. Deux jeunes hommes, polis et impeccablement habillés, s’invitent dans une maison de vacances et transforment un séjour banal en cauchemar à huis clos. La mise en scène est glaciale, frontale, presque hostile. Haneke casse le quatrième mur, nous interpelle, nous rend complices malgré nous. L’horreur n’est pas forcément dans ce qu’on l’on voit, mais surtout dans ce qu’on s’imagine, dans notre malaise, notre culpabilité de voyeur morbide.
En 2007, le cinéaste tourne lui-même un remake américain plan pour plan. Un auto remake, donc. Le résultat est troublant, presque identique, mais la version autrichienne conserve à mes yeux une brutalité que la copie ne retrouve pas. Pas de musique rassurante, pas de clin d’œil complice : juste un inconfort qui s’installe et refuse de disparaître.
Les Revenants (2012–2015)
Dans Les Revenants (2 saisons), la mort ne fait pas de bruit : elle revient simplement frapper à la porte. Dans une petite ville de montagne, aux alentours d’Annecy, des proches décédés réapparaissent comme si de rien n’était, sans explication. La série française installe un climat doux et glaçant à la fois, porté par une mise en scène minimaliste et une musique en apesanteur. Tout cela dans des paysages montagneux magnifiques.
Le remake américain, The Returned (2015), souffre d’un rythme accéléré qui m’a beaucoup dérangé. La lenteur, associée à un jeu d’acteur assez dur, et à des paysages tout aussi beaux que froids, apportait énormément de charme aux Revenants. On prenait le temps de découvrir les personnages, de s’y attacher, et malheureusement, nous perdons tout cela dans la version US. En allant trop vite, on perd cette sensation qu’un malaise invisible s’infiltre partout, sans jamais se nommer. Si vous aimez les récits fantastiques qui laissent de la place au mystère, je vous conseille de coupler Les Revenants avec Twin Peaks (1990–2017) ou The Leftovers (2014–2017), deux séries qui, elles aussi, préfèrent faire ressentir avant de vouloir tout expliquer.
Utopia (2013–2014)
Utopia (2 saisons) est une série qui ne ressemble à aucune autre. Couleurs fluo, violence sèche, complot mondial autour d’un manuscrit mystérieux : tout y est excessif, dérangeant, mais furieusement maîtrisé. On y suit des personnages ordinaires plongés dans une mécanique qui les dépasse, avec une bande-son et une direction artistique tellement singulières qu’on reconnaîtrait la série en un seul plan.
La version américaine de 2020, pourtant signée Gillian Flynn (scénariste de Gone Girl, tout de même), atténue cette folie graphique et narrative. Là où la version britannique vous prend à la gorge et refuse de vous lâcher, la copie paraît plus conventionnelle, plus prudente. L’original laisse une impression de fièvre qui revient longtemps après le visionnage. Si vous aimez quand une série prend des risques, même au prix de perdre une partie du public, Dirk Gently, détective holistique (2016), vous plaira certainement !
Infernal Affairs (2002)
Avant Les Infiltrés (2006), il y avait Infernal Affairs (1h41), thriller hongkongais tendu comme un câble. Deux hommes se traquent sans le savoir : un flic infiltré dans la pègre, un mafieux infiltré dans la police. Pas de digression, pas de graisse : la mise en scène est sèche, précise, entièrement dédiée à la montée en tension.
Le remake de Scorsese est excellent, plus ample, plus bavard, plus nourri de sa mythologie personnelle. Infernal Affairs fait un peu exception ici, car si je reste objectif, Les Infiltrés n’est pas moins bien. Mais je préfère l’original, et il m’est difficile d’expliquer pourquoi. Peut-être tout simplement parce que j’ai adoré son ambiance hongkongaise, ce qui fait que j’ai du mal à m’en détacher de ce film. Il conserve une élégance et une efficacité redoutables. Tony Leung et Andy Lau jouent parfaitement ce jeu de miroirs, tout en retenue et en regards fuyants.
Psychose (1960)
Psychose (1h49) reste l’un des grands chocs de l’histoire du cinéma : un motel perdu, une douche, un violon qui crisse, et soudain, plus rien n’est comme avant. Alfred Hitchcock manipule le spectateur avec un sadisme ludique, change de point de vue en plein milieu du récit, et installe une tension qui ne se dégonfle jamais. Anthony Perkins, en Norman Bates, est à la fois inquiétant, enfantin et tragique.
En 1998, Gus Van Sant tente un remake plan par plan avec Psycho. L’expérience est intrigante sur le papier, presque conceptuelle, mais elle montre surtout combien chaque cadre, chaque mouvement, chaque silence de l’original était habité. Reprendre les mêmes images ne suffit pas : on mesure, image après image, la différence entre l’exercice de style et l’invention pure. Si vous devez n’en voir qu’un, restez avec Hitchcock.